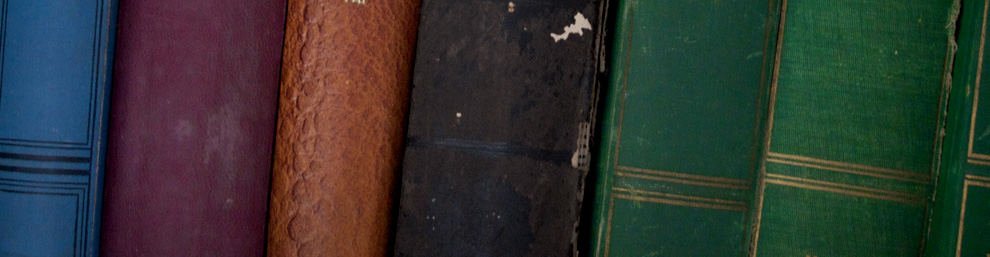Quand, il y a quelques mois, nous évoquions à Florence la mémoire d’Amrouche, c’est l’image de Moïse qui m’est venue à l’esprit — Moïse le berger du peuple hébreu, appelé à Dieu au seuil de cette terre promise qu’il ne devait jamais connaître. Il y a dans la nature d’Amrouche ce côté mystérieux et fataliste, qui avait son importance, côté habilement caché par la personnalité vigoureuse de l’homme entier, aimant la vie avec courage et obstination et allant, par habitude, jusqu’au fond des problèmes.
En 1956, avec d’autres amis, nous créions ensemble la revue Etudes Méditerranéennes, puis un an plus tard, nous mettions sur pieds les Colloques Méditerranéens de Florence. Amrouche voyait dans ces deux initiatives l’affirmation de ses convictions : II fallait tenter de contribuer à la création d’un climat de tolérance dans les relations humaines. Il nous disait souvent « si ces hommes de la Méditerranée pouvaient mieux se connaître, et de ce fait s’apprécier par-delà les barrières des différends politiques, en fin de compte, c’est l’homme qui imposerait sa loi ».Amrouche a été fidèle à ces deux entreprises. Avec Giorgio La Pira et les autres fondateurs, il n’a jamais reculé devant les difficultés énormes suscitées par le climat infernal de la politique méditerranéenne, afin que la cause du rapprochement entre les hommes s’affirme et entre dans les mœurs.
Dès notre première rencontre, en 1955, j’abordais avec lui le problème complexe des relations Judéo-Arabes. L’homme n’aimait pas les équivoques et savait clarifier ses positions. J’étais impressionné par la rigueur et l’honnêteté de son raisonnement. « Israël fait partie du paysage méditerranéen, de la raison d’être de cette région et de son âme. Il faut œuvrer pour que les hommes politiques le comprennent, car ceux qui ignorent cet élément de base méconnaissent ce qu’il y a de plus sacré dans cette partie du monde. L’Algérie de demain sera peut-être cette terre de rencontre où Chrétiens, juifs et Musulmans sauront créer le climat de confiance, essentiel à la réconciliation. La libération de cette terre d’Algérie aura certainement un effet pacifique sur les relations Judéo-Arabes. La vocation de mon peuple est de travailler en paix, et de créer… » Amrouche tenait ces propos aux hommes les plus divers, tels le Roi Mohammed V du Maroc et le Président Ben-Gourion d’Israël, avec la même foi et la même ferveur.
Aux jours les plus dramatiques de la guerre d’Algérie, quand la peur et la folie collective hantaient les diverses communautés, et que dans le tohu-bohu la loi de la jungle dominait, mes pensées allaient surtout vers les Juifs algériens, perdus dans la mêlée. Leur situation particulière risquait de les transformer en boucs-émissaires. Je fis part à Amrouche de mon inquiétude et lui demandais conseil. L’homme qui ne faisait aucun compromis avec sa vérité, ses convictions ou ses principes décida d’examiner ce problème avec ses amis, les chefs de la rébellion. Il alla à Tunis. J’apprenais plus tard qu’il avait plaidé le dossier juif avec générosité et conviction, dégageant le côté particulier et profondément humain d’un drame où les figurants risquaient de devenir les victimes. C’est à lui qu’il revient aussi d’avoir convaincu les leaders du F.L.N. de renoncer à leur opposition au décret Crémieux, décret qui accordait aux Juifs d’Algérie la nationalité française et de ce fait les séparait de la Communauté algérienne au sein de laquelle ils vivaient depuis des millénaires. Pour lui, l’annulation du dit décret risquait de semer la confusion et le chaos parmi les Juifs d’Algérie, qui depuis plusieurs générations pensaient en Français. « A-t-on le droit de retourner la roue de l’histoire ? »
Tel était l’homme, qui fidèle au rôle qu’il entendait jouer, refusait les fonctions les plus importantes. Ecarté de la R.T.F., il ne voulait à aucun prix quitter Paris car, disait-il « C’est ici que je peux donner le maximum pour que la guerre d’Algérie cesse et que mon pays se libère. La paix en Algérie se fera entre deux peuples désormais liés par un destin commun et une vocation commune, et il faut plaider cela à Paris aussi. » Amrouche s’est assigné ce rôle, il l’a rempli avec dignité, faisant honneur, tant à sa Kabylie natale, terre de ses ancêtres, qu’à cette France qu’il aimait, où il avait puisé sa culture et fondé sa famille. Il a disparu, quand Français et Algériens s’engageaient dans la voie de la réconciliation. De son Sinaï, Amrouche voyait ses idéaux se rapprocher de leur réalisation.
Son message est celui d’un homme qui, avant tout, avait confiance dans ses semblables. D’un homme pour qui la condition de l’existence créatrice de toute société, c’est-à-dire de sa survie, dépendait avant tout de l’esprit de tolérance animant les communautés qui la composent. D’un homme pour qui le pluralisme des cultures est un élément essentiel de lendemains meilleurs.
Joe Gouldin-Golan (Tel Aviv, Août 1962 ) In Etudes méditerranéennes, n°11, 2° trimestre, 1963, p 41-43.